La neurologie, il y a 100 ans, buissonnait : bourgeons prometteurs, inventions,
améliorations, branches mortes de la recherche… N’oublions pas nos Anciens !
 À tout seigneur, tout honneur : on célèbre en mai 1925 le centenaire de la naissance de Jean-Martin Charcot (1825-1893). Joseph Babinski préside les festivités, et le Président de la République (Gaston Doumergue) honore de sa présence la cérémonie tenue à la Sorbonne. Cent ans plus tard, en 2025, le bicentenaire de la naissance de Charcot sera célébré avec plus de recul, mais non sans faste (charcot2025.fr).
À tout seigneur, tout honneur : on célèbre en mai 1925 le centenaire de la naissance de Jean-Martin Charcot (1825-1893). Joseph Babinski préside les festivités, et le Président de la République (Gaston Doumergue) honore de sa présence la cérémonie tenue à la Sorbonne. Cent ans plus tard, en 2025, le bicentenaire de la naissance de Charcot sera célébré avec plus de recul, mais non sans faste (charcot2025.fr).
La Société de neurologie de Strasbourg, “filiale” de la Société neurologique de Paris,  tient sa première réunion en janvier 1925 sous la présidence de Joseph Babinski. Le maître des lieux, Jean Alexandre Barré (1880-1967), ancien élève de Babinski, inaugure les discours. Il est le premier signataire des cinq communications à l’ordre du jour. Quant à Babinski, il fait une conférence sur “l’interrogatoire en clinique et les symptômes subjectifs”. Il rapporte notamment l’histoire d’une femme qu’il avait examinée étant interne. Elle se plaignait de céphalées, vite cataloguées hystériques, avant qu’une autre patiente ne vint tirer Babinski par la manche en lui disant : « Vous êtes dans l’erreur ; la nouvelle venue n’est pas du tout hystérique (…) C’est du sérieux. » Ce que confirma son décès rapide, lié à une tumeur cérébelleuse. Une leçon dont Babinski dit avoir tiré profit… Il poursuit en renouvelant la critique des conceptions de l’hystérie de Charcot (sans le nommer), tout en constatant la quasi-disparition des hémianesthésies et des rétrécissements du champ visuel.
tient sa première réunion en janvier 1925 sous la présidence de Joseph Babinski. Le maître des lieux, Jean Alexandre Barré (1880-1967), ancien élève de Babinski, inaugure les discours. Il est le premier signataire des cinq communications à l’ordre du jour. Quant à Babinski, il fait une conférence sur “l’interrogatoire en clinique et les symptômes subjectifs”. Il rapporte notamment l’histoire d’une femme qu’il avait examinée étant interne. Elle se plaignait de céphalées, vite cataloguées hystériques, avant qu’une autre patiente ne vint tirer Babinski par la manche en lui disant : « Vous êtes dans l’erreur ; la nouvelle venue n’est pas du tout hystérique (…) C’est du sérieux. » Ce que confirma son décès rapide, lié à une tumeur cérébelleuse. Une leçon dont Babinski dit avoir tiré profit… Il poursuit en renouvelant la critique des conceptions de l’hystérie de Charcot (sans le nommer), tout en constatant la quasi-disparition des hémianesthésies et des rétrécissements du champ visuel.
 La Société neurologique de Paris, future Société française de neurologie, fête son 25e anniversaire. Le Président est Georges Guillain (1876-1961). Henry Meige, après 20 ans à ce poste, quitte la fonction de secrétaire général, remplacé par le président précédent, Louis Crouzon (1874-1938). La Société accueille quelques nouveaux membres, en particulier Gabrielle Lévy (1886-1934).
La Société neurologique de Paris, future Société française de neurologie, fête son 25e anniversaire. Le Président est Georges Guillain (1876-1961). Henry Meige, après 20 ans à ce poste, quitte la fonction de secrétaire général, remplacé par le président précédent, Louis Crouzon (1874-1938). La Société accueille quelques nouveaux membres, en particulier Gabrielle Lévy (1886-1934).
La deuxième réunion de Strasbourg voit Guillain retrouver Barré. Lors d’une autre réunion, c’est Achille Souques (1860-1944) qui tient une conférence sur un type de métastase vertébrale qu’il a, l’année précédente, qualifiée de « vertèbre d’ivoire » en raison de son aspect radiologique.
Lors d’une autre réunion, c’est Achille Souques (1860-1944) qui tient une conférence sur un type de métastase vertébrale qu’il a, l’année précédente, qualifiée de « vertèbre d’ivoire » en raison de son aspect radiologique.
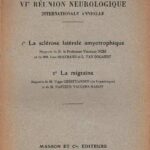 La sixième réunion neurologique internationale annuelle a lieu les 25 et 27 mai. Elle est consacrée à la sclérose latérale amyotrophique et à la migraine.
La sixième réunion neurologique internationale annuelle a lieu les 25 et 27 mai. Elle est consacrée à la sclérose latérale amyotrophique et à la migraine.
Parmi les communications à la Société neurologique de Paris, on relève l’exérèse  réussie d’une tumeur de l’angle ponto-cérébelleux par « extirpation intracapsulaire par morcellement, suivant les indications de Cushing », en position assise et sous anesthésie locale. L’opérateur est Thierry de Martel (1875-1940), pionnier de la neurochirurgie française avec Clovis Vincent. La malade était suivie par Babinski, qui soutenait l’essor de la neurochirurgie en France.
réussie d’une tumeur de l’angle ponto-cérébelleux par « extirpation intracapsulaire par morcellement, suivant les indications de Cushing », en position assise et sous anesthésie locale. L’opérateur est Thierry de Martel (1875-1940), pionnier de la neurochirurgie française avec Clovis Vincent. La malade était suivie par Babinski, qui soutenait l’essor de la neurochirurgie en France.
 La thèse de Gabrielle Lévy (1886-1934), Les manifestations tardives de l’encéphalite épidémique, est publiée sous forme d’un livre, chez Doin.
La thèse de Gabrielle Lévy (1886-1934), Les manifestations tardives de l’encéphalite épidémique, est publiée sous forme d’un livre, chez Doin.
Willi (Wilhem) Kleine (1897-1968), neurologue à Francfort, publie cinq cas 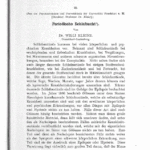 d’hypersomnie récurrente. Max Levin, psychiatre, note l’hyperphagie en 1930, tandis que MacDonald Critchley et Hovell Hoffman définissent le syndrome et lui donnent son éponyme (syndrome de Kleine-Levin) en 1942.
d’hypersomnie récurrente. Max Levin, psychiatre, note l’hyperphagie en 1930, tandis que MacDonald Critchley et Hovell Hoffman définissent le syndrome et lui donnent son éponyme (syndrome de Kleine-Levin) en 1942.
 Parution du livre-enquête d’Albert Londres (1884-1932) : Chez les fous (Albin Michel, Paris). Le journaliste Albert Londres a réalisé un tour de France des asiles et autres services accueillant des “fous”. Sa conclusion est sans appel : « La façon dont notre société traite les citoyens dits aliénés date de l’âge des diligences. (…). La loi de 1838 (…) est une loi de débarras. » Et à la fin : « Notre devoir n’est pas de nous débarrasser du fou, mais de débarrasser le fou de sa folie. Si nous commencions ? »
Parution du livre-enquête d’Albert Londres (1884-1932) : Chez les fous (Albin Michel, Paris). Le journaliste Albert Londres a réalisé un tour de France des asiles et autres services accueillant des “fous”. Sa conclusion est sans appel : « La façon dont notre société traite les citoyens dits aliénés date de l’âge des diligences. (…). La loi de 1838 (…) est une loi de débarras. » Et à la fin : « Notre devoir n’est pas de nous débarrasser du fou, mais de débarrasser le fou de sa folie. Si nous commencions ? »
Dans un livre publié chez Doin (Étude clinique et anatomopathologique des syndromes neuroanémiques, en particulier des dégénérescences combinées subaiguës de la moelle avec anémie), Pierre Matthieu réunit sous le nom de syndrome neuro-anémique les complications périphériques, médullaires et encéphaliques des anémies. Les travaux sur la vitamine B12 et son rôle en pathologie n’apparaîtront qu’à partir des années 1950.
Parution du livre Die Dytoerchitektonik der Hirnrinde des erwashsenen Menschen (La  cytoarchitectonie du cortex cérébral de l’homme adulte), coécrit par Constantin Von Economo (1876-1931) et Georg Koskinas (1885-1975). Von Economo y décrit les neurones en fuseau, qui portent son nom. Pour certains auteurs, l’apparition de ces neurones accompagne celle de comportements sociaux complexes et de capacités cognitives et affectives spécialisées.
cytoarchitectonie du cortex cérébral de l’homme adulte), coécrit par Constantin Von Economo (1876-1931) et Georg Koskinas (1885-1975). Von Economo y décrit les neurones en fuseau, qui portent son nom. Pour certains auteurs, l’apparition de ces neurones accompagne celle de comportements sociaux complexes et de capacités cognitives et affectives spécialisées.
 Walter Dandy (1886-1946), neurochirurgien américain, prône la section partielle du
Walter Dandy (1886-1946), neurochirurgien américain, prône la section partielle du
nerf trijumeau dans la fosse postérieure afin de traiter la névralgie du trijumeau.
Charles Sherrington (1857-1952), neurophysiologiste britannique,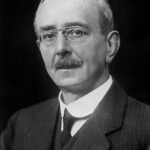 introduit le terme d’unité motrice (motor unit) pour désigner l’unité de base de la fonction motrice : un neurone moteur et le groupe de fibres musculaires qu’il innerve.
introduit le terme d’unité motrice (motor unit) pour désigner l’unité de base de la fonction motrice : un neurone moteur et le groupe de fibres musculaires qu’il innerve.
 Josef Gertsmann (1887-1969), neurologue d’origine autrichienne (émigré aux États-Unis lors de l’Anschluss) plus connu pour ses travaux ultérieurs de neuropsychologie et pour la description d’une maladie à prions, publie une monographie sur le traitement par impaludation de la neurosyphilis, inventé en 1917 par un autre autrichien, Julius Wagner-Jauregg (1857-1940), dont Gerstmann avait été l’assistant.
Josef Gertsmann (1887-1969), neurologue d’origine autrichienne (émigré aux États-Unis lors de l’Anschluss) plus connu pour ses travaux ultérieurs de neuropsychologie et pour la description d’une maladie à prions, publie une monographie sur le traitement par impaludation de la neurosyphilis, inventé en 1917 par un autre autrichien, Julius Wagner-Jauregg (1857-1940), dont Gerstmann avait été l’assistant.
Plusieurs décès sont à déplorer, notamment ceux de :
 – Hugo Liepmann (1863-1925), neuropsychiatre allemand, connu
– Hugo Liepmann (1863-1925), neuropsychiatre allemand, connu
pour ses travaux sur l’apraxie ;
– Adolf Strümpell (1853-1925), neurologue allemand, dont le nom est associé à la paraplégie spastique héréditaire, qu’il a décrite en 1880, 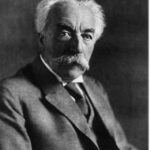 tandis que Maurice Lorrain y consacra sa thèse en 1888 ;
tandis que Maurice Lorrain y consacra sa thèse en 1888 ;
– Armand de Watteville (1846-1925), neurologue né à Londres d’une famille suisse, complètement oublié, mais qui fut l’un des premiers éditeurs du journal Brain et forgea probablement le premier le terme neurologue (neurologist).
Et quelques naissances à cé lébrer, dont celles de :
lébrer, dont celles de :
– Michel Jouvet (1925-2017), grand spécialiste lyonnais du sommeil, à qui l’on doit, entre autres, l’individualisation du sommeil paradoxal ;
– Patrick Wall (1925-2001), neurophysiologiste anglais, spécialiste de la douleur, auteur avec son collègue Ronald Melzack (1929-2019) de la théorie de modulation de la douleur (gate control) à laquelle leur nom est attaché.
Aucun prix Nobel de médecine ou physiologie n’est attribué cette année-là, faute de consensus.




